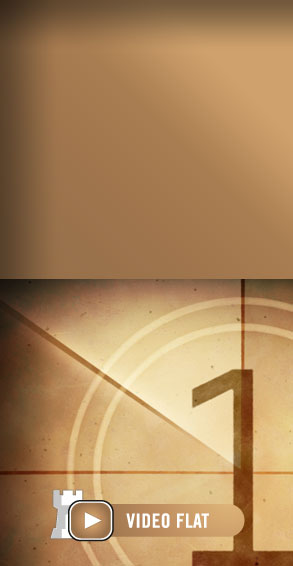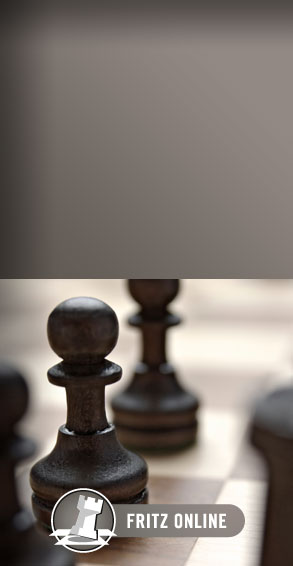Introduction
Lorsque nous parlons de dopage génétique, nous désignons l’«utilisation intentionnelle d’outils de biologie moléculaire pour introduire, éditer ou moduler des gènes afin d’augmenter les performances sportives». À la lumière des avancées récentes, il ne s’agit plus uniquement de substances interdites: on recourt à des vecteurs viraux (comme les AAV), à l’édition génique (grâce à CRISPR-Cas9), à l’ARN interférent ou à la modulation épigénétique pour activer ou inhiber des voies physiologiques (endurance, force, récupération) et même des fonctions cognitives cruciales (attention, contrôle exécutif).
Le dopage génétique se distingue de la thérapie génique (supposée restaurer la santé) par son objectif d’optimisation chez des sujets sains, brouillant, peut-être, la frontière entre guérir et améliorer, mais conforme dans les deux cas à la folie prométhéenne que nous annonçait Mary Shelley en 1818. Comme pour un autre moment de folie collectivement récemmet vécu où l'on prenait pour argent comptant l'annonce, par le directeur de la production lui-même, de produits issus de la biotechnologie comme étant "sûrs et efficaces à 95%", la publicité pour le dopage génétique garantit une efficacité accrue et des effets durables, au prix toutefois de quelques risques: réactions immunitaires, altérations hors cible, effets tardifs inconnus et inégalités compétitives.
À noter que la détection du dopage par cette méthode est quasi impossible (modifications endogènes), ce qui mettra enfin un terme à l'hypocrite contrôle antidopage, tout en posant la question de jusqu’où peut-on redessiner l’athlète pour qu'il soit encore légitime de lui conférer quelque mérite à ses succès?
Grandes transformations
Les progrès en neuroscience et biotechnologie ont bouleversé les débats éthico-philosophiques, y compris dans le domaine du sport où l'une des controverses les plus vives concernent le dopage génétique, défini par l’AMA comme l’introduction ou la modulation de gènes à des fins d’amélioration.
Deux visions s’opposent:
- Transhumanistes: partisans de la légitimité des technologies d’amélioration humaine.
- Bioconservateurs: défenseurs de l’essence du sport et de la dignité humaine.
Ce débat s’inscrit dans la neuroéthique sociale, qui analyse l’impact culturel, éducatif et sociétal des neurosciences.
Le sport à l'ère de la Société du Spectacle et le principe de performance
Selon Huizinga et Guttmann, le sport moderne s’est éloigné de sa dimension ludique originelle pour devenir un système bureaucratique et rationalisé, centré sur le principe de performance. Le record et la devise citius, altius, fortius – «plus vite, plus haut, plus fort» –ont légitimé l’exigence extrême et la quête d’améliorations artificielles – sans compter l'attente du Spectateur, dont la quantité est souvent proportionnelle aux contreparties financières espérées en retour de l'investissement..
Le dopage génétique est l’extension logique de la place spectaculaire qu'a pris le sport dans la société: il ne s’agit plus seulement d’entraînement et de nutrition plus ou moins "stimulés", mais d’intervention sur la structure biologique de l’athlète.
Perspective transhumaniste
Critiquant le dopage traditionnel pour ses effets incertains et nocifs, il plaide pour lever l’interdiction afin de l’étudier ouvertement. Il voit dans l’ingénierie génétique un moyen de corriger les inégalités de la «loterie génétique», favorisant ainsi l’égalité des chances. Il assimile la manipulation somatique aux usages thérapeutiques: si l’on accepte la génétique pour guérir, pourquoi pas pour performer?
Problème central: cette position contredit le principe de dignité humaine et risque de réduire le corps de l’athlète à un moyen lucratif plutôt qu’à une fin en soi – mais y a-t-il là quelque chose de vraiment neuf sous le soleil capitaliste?
Il défend la légitimité morale du dopage sous conditions de liberté et de régulation. Il prône une légalisation contrôlée pour garantir égalité, justice et sécurité. Interdire le dopage crée des inégalités: beaucoup s’y adonnent en secret. Pour lui, choisir de se doper équivaut à choisir un entraînement ou un régime.
Risque éthique: normaliser une logique mercantiliste qui détruit l’éthos moral du sport – pour les bienpensants qui s'aveuglent à croire que cet éthos moral a réellement existé avant la problématique du transhumanisme...
Perspective bioconservatrice
Dans The Case Against Perfection, il rejette le perfectionnement technologique car il porte atteinte à la gratuité du don humain et à l’authenticité du talent. Le sport perdrait son essence si l’effort et le talent naturel étaient remplacés par des améliorations artificielles.
Il distingue:
- Amélioration restaurative (légitime): ex. chirurgie oculaire de Tiger Woods.
- Amélioration optimisatrice (illégitime): elle supplante le talent inné.
Selon lui, les prothèses bioniques d'Oscar Pistorius sont légitimes si elles permettent d’exprimer un talent naturel (sous conditions).
Conclusion: le dopage génétique défigure la dignité et la finalité intrinsèque du sport.
À travers une éthique internaliste de la compétition, il dénonce le dopage (y compris génétique) comme une auto-illusion morale: croire que la victoire dépend de substances externes plutôt que de l’effort. L’excellence sportive doit naître de la disposition naturelle et de l’entraînement discipliné. Les drogues n’offrent que des avantages marginaux contre des risques graves. Le dopage réduit l’athlète à un organisme fonctionnel au service du spectacle.
Implications éthiques et philosophiques
L’athlète ne peut être réduit à un moyen économique ou à une démonstration technologique – autant dire qu'il y a belle lurette que cette dignité n'existe plus guère...
Le dopage génétique creuse des inégalités abyssales et brise le «level playing field» («terrain de jeu équitable»).
Le sport est un laboratoire culturel. Accepter le dopage génétique transformerait la perception de l’effort, du mérite et de l’identité humaine.
- Risque de marchandisation
Le sport pourrait se dégrader en spectacle biotechnologique, perdant définitivement sa dimension éducative, sociale et morale déjà considérablement mis à mal.
Conclusions
Le choc entre transhumanistes (Savulescu, Tamburrini) et bioconservateurs (Sandel, Simon) révèle des visions antagonistes de l’avenir du sport et de l’humanité:
- Les premiers misent sur la liberté technologique, assimilant le dopage génétique à des choix personnels (entraînement, santé).
- Les seconds dénoncent une corruption de l’essence sportive, une dégradation de la dignité et une érosion des valeurs de justice, mérite et don.
En philosophie du sport et éthique du dopage, on conclut que:
- Le dopage génétique n’équivaut pas à des traitements restauratifs.
- La neuroéthique sociale doit anticiper les impacts du dopage génétique via une régulation interdisciplinaire.
- Le défi est culturel: il implique une redéfinition de l’excellence sportive, et des concepts d’humanité et de justice.
Sources
- Blanco Hernández, U. ¿Es posible el dopaje genético en ajedrecistas? (1). ChessBase, 11/06/2021.
- Miah, A. (2004). Genetically modified athletes: Biomedical ethics, gene doping and sport. Routledge.
- Sandel, M. J. (2007). The case against perfection: Ethics in the age of genetic engineering. Harvard University Press.
- Savulescu, J., & Bostrom, N. (Eds.). (2009). Human enhancement. Oxford University Press.
- Savulescu, J., Foddy, B., & Clayton, M. (2004). Why we should allow performance enhancing drugs in sport. British Journal of Sports Medicine, 38 (6), 666–670.
- Solanes, R. F. S. (2013). Transhumanistas y bioconservadores en torno al dopaje genético. Revista de pensament i anàlisi, (13), 121-136.
- World Anti-Doping Agency. (2024, September 12). List of Prohibited Substances and Methods.